De musica sacra et sacra liturgia (SCR 1958)
Chapitre premier
Notions Générales
1. « La sainte liturgie constitue le culte public intégral du Corps mystique de Jésus-Christ, c'est-à-dire de son Chef et de ses membres. » [1] C'est pourquoi sont « actions liturgiques » ces actions sacrées qui, par institution de Jésus-Christ ou de l'Église et en leur nom, selon les livres liturgiques approuvés par le Saint-Siège, sont accomplies par les personnes qui y sont légitimement députées, pour rendre le culte qui leur est dû à Dieu, aux Saints et aux Bienheureux (cf. can. 1256) ; les autres actions sacrées qui sont accomplies soit dans l'église soit au dehors, même si le prêtre y est présent, ou les préside, sont appelées « pieux exercices ».
2. Le saint sacrifice de la messe est un acte du culte public, acquitté au nom du Christ et de l'Église, qu'il soit célébré en quelque lieu, ou de quelque manière que ce soit. On évitera donc l'expression de « messes privées ».
3. Il y a deux catégories de messes : la messe chantée (« in cantu ») et la messe lue.
La messe est dite chantée si le prêtre célébrant chante vraiment les parties qu'il doit chanter selon les rubriques ; autrement elle est dite lue.
Quant à la messe chantée, si elle est célébrée avec assistance de ministres sacrés, elle est appelée messe solennelle ; si elle est célébrée sans ministres sacrés, elle est appelée messe chantée ordinaire.
4. Sous le nom de « musique sacrée » on englobe ici :
a) le chant grégorien.
b) la polyphonie sacrée.
c) la musique sacrée moderne.
d) la musique sacrée pour orgue.
e) le chant populaire religieux.
f) la musique religieuse.
5. Le chant « grégorien » qui doit être employé dans les actions sacrées, est le chant sacré de l'Église romaine, qui, saintement et fidèlement cultivé et réglé selon une antique et vénérable tradition, ou même composé à des époques récentes selon les modèles de la tradition ancienne, est proposé pour l'usage liturgique dans les différents livres dûment approuvés par le Saint-Siège. Le chant grégorien, par sa nature, n'exige pas d'être exécuté avec accompagnement de l'orgue ou d'un autre instrument de musique.
6. Sous le nom de « polyphonie sacrée » on entend ce chant mesuré qui, né des unissons grégoriens, composé de plusieurs voix, sans l'accompagnement d'aucun instrument de musique, a commencé à être en vigueur au moyen âge dans l'Église latine, eut son plus grand compositeur dans la seconde moitié du XVIe siècle avec Pierluigi Palestrina (1525-1594), et est encore pratiqué aujourd'hui par d'éminents maîtres en cet art.
7. « La musique sacrée moderne » est la musique qui, comportant l'étagement de plusieurs voix, sans exclure les instruments de musique, a été composée à une époque plus récente, conformément au progrès de l'art musical. Elle aussi, lorsqu'elle est directement ordonnée à l'usage liturgique, doit respirer la piété et le sens religieux et, à cette condition, est admise à servir la liturgie.
8. « La musique sacrée pour orgue » est la musique composée pour l'orgue seul qui, depuis l'époque où l'orgue à tuyaux s'est montré plus apte aux accords, a été cultivée par d'illustres maîtres et qui, si l'on suit exactement les lois de la musique sacrée, peut contribuer beaucoup à embellir la liturgie.
9. « Le chant populaire religieux » est ce chant qui jaillit spontanément du sentiment religieux dont la créature humaine a été dotée par son Créateur et qui, par conséquent est universel, c'est-à-dire qu'il fleurit chez tous les peuples.
Comme ce chant est très apte à imprégner d'esprit chrétien la vie des fidèles, tant privée que sociale, il a été cultivé activement dans l'Église [2] depuis les temps les plus reculés, et à notre époque il est vivement recommandé pour favoriser la piété des fidèles et embellir les pieux exercices ; il peut même être parfois admis dans les actions liturgiques elles-mêmes [3].
10. « La musique religieuse » enfin est celle qui, par l'intention de l'auteur aussi bien que par le thème et la fin de l'oeuvre, vise à exprimer et à susciter des sentiments pieux et religieux, et par conséquent « aide beaucoup la religion » [4] ; mais comme elle n'est pas ordonnée au culte divin et qu'elle présente un caractère plus libre, elle n'est pas admise dans les actions liturgiques.
Chapitre II
Normes Générales
11. Cette Instruction a force de loi pour tous les rites de l'Église latine ; par conséquent, ce qui est dit du chant grégorien vaut aussi pour le chant liturgique propre, là où il existe, des autres rites latins.
Par le terme de « musique sacrée » on entend, dans cette Instruction, parfois « le chant et le son des instruments », parfois seulement « le son des instruments », comme il appert facilement du contexte.
Enfin, dans le terme d'« église », on englobe ordinairement tout « lieu sacré », c'est-à-dire : l'église au sens strict, l'oratoire public, semi-public, privé (cf. can. 1154, 1161, 1188), à moins que le contexte ne montre clairement qu'il s'agit des églises au sens strict.
12. Les actions liturgiques doivent être accomplies selon les livres liturgiques dûment approuvés par le Siège Apostolique, soit pour l'Église universelle, soit pour une Église particulière ou une famille religieuse (cf. can. 1257) tandis que les pieux exercices se font selon les coutumes et les traditions des lieux ou des groupements, approuvées par les autorités religieuses compétentes (cf. can. 1259).
Il n'est pas permis de mêler entre eux des actions liturgiques et les pieux exercices ; mais, le cas échéant, les pieux exercices doivent suivre ou précéder les actions liturgiques.
13. a) La langue des actions liturgiques est le latin, à moins que dans les livres liturgiques sus-mentionnés, soit généraux, soit particuliers, pour certaines actions liturgiques, une autre langue soit admise explicitement, et sauf les exceptions qui sont énumérées ci-dessous.
b) Dans les actions liturgiques chantées, il n'est permis de chanter aucun texte liturgique traduit mot à mot en langue du peuple [5], sauf concessions particulières.
c) Les exceptions particulières à la loi selon laquelle on doit employer uniquement la langue latine dans les actions sacrées, qui ont été concédées par le Saint-Siège, demeurent en vigueur ; mais, sans l'autorité du Saint-Siège, il n'est pas permis d'en étendre l'interprétation ou de les appliquer à d'autres régions.
d) Dans les pieux exercices on peut employer n'importe quelle langue selon la convenance des fidèles.
14. a) Dans les messes chantées la langue latine seule doit être employée, non seulement par le prêtre célébrant et les ministres, mais aussi par la Schola ou les fidèles.
« Cependant, là où une coutume séculaire ou immémoriale admet qu'à la messe solennelle c'est-à-dire aux messes in cantu, après que les paroles sacrées de la liturgie ont été chantées en latin, on introduise quelques cantiques populaires en langue vulgaire, les Ordinaires des lieux pourront le laisser faire « si, étant donné les conditions des lieux et des personnes, ils jugent que cette [coutume] ne peut pas en prudence être déracinée » (Can. 5), en maintenant cependant la loi qui prescrit qu'on ne doit pas chanter une traduction littérale en langue vulgaire des paroles liturgiques. » [6]
b) Dans les messes lues, le prêtre célébrant, son ministre, et les fidèles qui participent directement à l'action liturgique avec le prêtre célébrant, c'est-à-dire qui disent à haute voix les parties de la messe qui leur reviennent (cf. n° 31), doivent employer uniquement la langue latine.
Mais si les fidèles, outre cette participation liturgique directe, désirent ajouter certaines prières ou certains chants populaires selon la coutume des lieux, cela peut se faire aussi dans la langue maternelle.
c) La récitation à haute voix avec le prêtre célébrant de parties du Propre, de l'Ordinaire et du Canon de la messe, que ce soit en latin ou dans une traduction mot à mot, que ce soit par tous les fidèles, ou par un commentateur, est strictement interdite, sauf ce qui est énuméré au n° 31.
Mais il est souhaitable que les dimanches et jours de fêtes, aux messes lues, l'Évangile et aussi l'Épître soient lus par un lecteur, en langue maternelle, pour l'utilité des fidèles.
En outre, de la Consécration au Pater noster, on conseille un silence sacré.
15. Dans les processions décrites par les livrés liturgiques, on emploiera la langue que ces livres prescrivent ou permettent ; mais dans les autres processions, qui se font à la manière de pieux exercices, on peut employer la langue qui convient le mieux aux fidèles participants.
16. Le chant grégorien est un chant sacré, le chant propre et principal de l'Église romaine ; c'est pourquoi, dans toutes les actions liturgiques non seulement il peut être employé mais encore, toutes choses égales d'ailleurs, il doit être préféré aux autres genres de la musique sacrée.
Par suite :
a) La langue du chant grégorien, en tant que chant liturgique, est uniquement la langue latine.
b) Les parties des actions liturgiques qui, selon les rubriques, doivent être chantées par le prêtre célébrant et par ses ministres, doivent être chantées uniquement selon les mélodies grégoriennes réglées dans les éditions typiques, tout accompagnement d'instrument étant interdit.
La Schola et le peuple, quand ils répondent en vertu des rubriques au chant du prêtre et des ministres, doivent de même employer uniquement ces mélodies grégoriennes.
c) Enfin, là où il a été permis par des Indults particuliers que, dans la messe chantée, le prêtre célébrant, le diacre ou le sous-diacre, ou le lecteur, après avoir chanté le texte de l'Épître ou de la Leçon et de l'Évangile avec les mélodies grégoriennes, puissent proclamer ces textes aussi en langue maternelle, cela doit se faire en lisant à voix haute et claire, à l'exclusion de toute cantilène grégorienne, qu'elle soit authentique ou pastichée (cf. n° 96 e).
17. La polyphonie sacrée peut être employée dans toutes les actions liturgiques, à cette condition cependant qu'on ait une schola qui puisse l'exécuter selon les règles de l'art. Ce genre de musique convient davantage aux actions liturgiques qui doivent être célébrées avec un éclat plus solennel.
18. De même, la musique sacrée moderne peut être admise dans toutes les actions liturgiques si, en fait, elle répond à la dignité, à la gravité et à la sainteté de la liturgie, et qu'on ait une schola capable de l'exécuter selon les règles de l'art.
19. Le chant populaire religieux peut être librement employé dans les pieux exercices ; mais dans les actions liturgiques, on observera strictement ce qui a été statué ci-dessus, nos 13-15 ;
20. La musique religieuse doit être absolument écartée de toutes les actions liturgiques ; mais dans les pieux exercices elle peut être admise ; quant aux concerts dans les lieux sacrés, on observera les normes données ci-dessous, nos 54 et 55.
21. Tout ce qui doit être chanté, selon les livres liturgiques, soit par le prêtre et ses ministres, soit par la schola ou le peuple, appartient intégralement à la liturgie elle-même. C'est pourquoi :
a) Il est strictement interdit de changer, de quelque manière que ce soit, l'ordre du texte à chanter, d'en altérer ou d'en omettre des paroles, ou de les répéter abusivement. Dans les chants, également, qui relèvent de la polyphonie sacrée et de la musique sacrée moderne, chacune des paroles du texte doit être perçue clairement et distinctement.
b) Pour le même motif, en toute action liturgique, il est explicitement défendu d'omettre, soit totalement soit en partie, aucun texte liturgique qui doit être chanté, à moins que les rubriques n'en aient disposé autrement.
c) Mais si, pour une cause raisonnable, par exemple le nombre insuffisant des chanteurs, ou leur imparfaite habileté dans l'art du chant, ou encore parfois, à cause de la longueur d'un rite ou d'un chant, l'un ou l'autre texte, qui revient à la schola, ne peut être chanté tel qu'il est noté dans les livres liturgiques, il est seulement permis de chanter intégralement ces textes, soit recto tono, soit à la manière des psaumes, avec accompagnement d'orgue si l'on veut.
Chapitre III
Normes Spéciales
A. De la messe.
a) Quelques principes généraux concernant la participation des fidèles.
22. De sa nature, la messe requiert que tous ceux qui y sont présents y participent selon leur mode propre.
a) Cette participation doit être avant tout intérieure, c'est-à-dire qu'elle s'exerce par la pieuse attention de l'esprit et par les sentiments du coeur ; c'est par elle que les fidèles « doivent très étroitement s'unir au Souverain Prêtre ... et offrir avec lui et par lui le Sacrifice, et se donnent avec lui » [7].
b) La participation des assistants devient plus complète si à l'attention intérieure se joint la participation extérieure, c'est-à-dire manifestée par des actes extérieurs, tels que l'attitude corporelle (en s'agenouillant, se tenant debout, s'asseyant), les gestes rituels, mais surtout par les réponses, les prières et le chant.
De cette participation le Souverain Pontife Pie XII dans l'Encyclique Mediator Dei, sur la liturgie, fait l'éloge suivant :
« Ceux-là méritent des louanges qui s'efforcent de faire de la liturgie une action sainte même extérieurement, à laquelle prennent réellement part tous les assistants, ce qui peut se réaliser de diverses manières quand, par exemple, tout le peuple, selon les règles rituelles, ou bien répond d'une façon bien réglée aux paroles du prêtre, ou se livre à des chants en rapport avec les différentes parties du Sacrifice, ou bien fait l'un et l'autre, ou enfin lorsque dans les messes solennelles il répond aux prières des ministres de Jésus-Christ et s'associe au chant liturgique. » [8].
C'est cette participation harmonieuse que visent les documents pontificaux lorsqu'ils parlent de « participation active » [9], dont on trouve le modèle éminent chez le prêtre célébrant et ses ministres, qui avec la piété intérieure requise et l'exacte observance des cérémonies, accomplissent le service de l'autel.
c) Enfin on obtient une parfaite participation active quand s'y joint aussi la participation sacramentelle par laquelle « les fidèles assistants communient non seulement par un élan spirituel, mais aussi encore par la réception sacramentelle de l'Eucharistie, pour qu'ils obtiennent un fruit plus abondant de ce sacrifice très saint. » [10].
d) Mais puisque la participation consciente et active des fidèles ne peut être obtenue s'ils ne sont suffisamment instruits, il est bon de rappeler à la mémoire la sage loi établie par les Pères de Trente, qui prescrit :
« Le saint Concile ordonne aux pasteurs et à tous ceux qui ont la charge des âmes, d'expliquer souvent, par eux-mêmes ou par d'autres, au cours de la célébration de la messe [c'est-à-dire dans l'homélie qui suit l'évangile ou « lorsque la catéchèse est présentée au peuple chrétien, principalement les dimanches et les fêtes, quelque chose de ce qui s'y lit, et qu'ils s'attachent particulièrement à faire entendre quelque mystère de ce sacrifice très saint. » [11]
23. Les manières variées dont les fidèles peuvent participer activement au saint Sacrifice de la messe doivent être réglées de telle sorte que soit éloigné le danger de tout abus, et que soit obtenue la fin principale de cette participation, c'est-à-dire une plus grande plénitude dans le culte de Dieu et l'édification des fidèles.

b) De la participation des fidèles aux messes chantées.
24. La forme la plus noble de la célébration eucharistique consiste dans la messe solennelle où la solennité réunie des cérémonies, des ministres, et de la musique sacrée manifeste la magnificence des mystères divins et conduit les âmes des assistants à la pieuse contemplation de ces mystères. Il faut donc faire effort pour que les fidèles attribuent à cette forme de célébration l'estime qui lui est due, en y participant dignement, comme on l'expose ci-dessous.
25. C'est pourquoi, dans la messe solennelle, la participation des fidèles peut se réaliser en trois degrés :
a) Le premier degré est obtenu quand tous les fidèles donnent en chantant les réponses liturgiques : Amen ; Et cum spiritu tuo ; Gloria, tibi, Domine ; Habemus ad Dominum ; Dignum et justum est ; Sed libera nos a malo ; Deo gratias. On doit travailler avec tout le soin possible à ce que tous les fidèles, dans le monde entier, soient capables de donner ces réponses liturgiques en chantant.
b) Le second degré est obtenu lorsque tous les fidèles chantent en outre les parties de l'Ordinaire de la messe, à savoir : Kyrie, eleison ; Gloria in excelsis Deo ; Credo ; Sanctus-Benedictus ; Agnus Dei. Il faut faire effort pour que les fidèles sachent chanter ces parties de l'Ordinaire de la messe, surtout avec les mélodies grégoriennes le plus simples. Mais s'ils ne peuvent chanter toutes ces parties, rien n'empêche que les plus faciles, comme Kyrie, eleison ; Sanctus-Benedictus ; Agnus Dei, soient choisies pour être chantées par tous les fidèles, tandis que le Gloria in excelsis Deo et le Credo sont chantés par la « Schola cantorum ».
D'autre part, il faut veiller à ce que, dans le monde entier, soient apprises par les fidèles les mélodies grégoriennes les plus faciles, qui sont : Kyrie, eleison, Sanctus-Benedictus et Agnus Dei de la messe n° XVI du Graduel romain ; le Gloria in excelsis Deo avec l'Ite, missa est - Deo gratias de la messe XV, et le Credo n° I ou n° III. De cette manière on peut obtenir, ce qui est extrêmement souhaitable, que les chrétiens dans le monde entier, puissent manifester leur foi commune dans la participation active au saint sacrifice de la messe, par un unisson commun et joyeux [12].
c) Enfin le troisième degré est obtenu lorsque tous les assistants sont tellement exercés au chant grégorien qu'ils peuvent chanter également les parties du Propre. Cette pleine participation au chant doit être poussée surtout dans les communautés religieuses et les séminaires.
26. Il faut aussi avoir une grande estime pour la messe chantée, qui à défaut des ministres et de la pleine magnificence des cérémonies, est cependant rehaussée par la beauté du chant et de la musique sacrée.
II faut souhaiter que les dimanches et les jours de fêtes, la messe paroissiale ou principale soit chantée.
Ce qu'on a dit au paragraphe précédent sur la participation des fidèles à la messe solennelle, est également tout à fait valable pour la messe chantée.
27. Pour les messes chantées, il faut encore remarquer ceci :
a) Si le prêtre avec les ministres fait son entrée dans l'église par un itinéraire assez long, rien n'empêche qu'une fois chantée l'antienne d'Introït avec son verset, on chante encore plusieurs autres versets de ce psaume ; en ce cas, on peut reprendre l'antienne après chaque verset, ou tous les deux versets ; et quand le célébrant est arrivé devant l'autel, après avoir interrompu le psaume, s'il le faut, on chante Gloria Patri, et on reprend l'antienne une dernière fois.
b) Après l'antienne d'offertoire, on peut chanter les antiques mélodies de ces versets qui jadis étaient chantés après l'antienne.
Si l'antienne d'offertoire est extraite d'un psaume, il est permis de chanter les autres versets de ce psaume ; en ce cas, après chacun des versets, ou tous les deux versets, on peut reprendre l'antienne et, l'offertoire une fois achevé, on termine le psaume par Gloria Patri, et on reprend l'antienne. Si l'antienne n'est pas extraite d'un psaume, on peut choisir un autre psaume accordé à la solennité. On peut cependant chanter, une fois achevée l'antienne d'offertoire, un petit chant latin, qui soit toutefois accordé à cette partie de la messe, et qui ne se prolonge pas au-delà de la Secrète.
c) L'antienne de communion, de soi, doit être chantée tandis que le prêtre célébrant communie. Si des fidèles doivent communier, on commencera le chant de cette antienne pendant que le prêtre distribue la sainte communion. Si cette antienne de communion est extraite d'un psaume, il est permis de chanter les autres versets de ce psaume ; en ce cas, après chaque verset ou tous les deux versets, on peut reprendre l'antienne et, la communion achevée, on termine le psaume par Gloria Patri, et on reprend l'antienne. Et si l'antienne n'est pas prise à un psaume, on peut choisir un psaume accordé à la solennité et à l'action liturgique.
Une fois achevée l'antienne de communion, surtout si la communion des fidèles se prolonge beaucoup, il est permis de chanter aussi un autre petit chant latin, accordé à l'action sacrée.
En outre, les fidèles qui vont accéder à la sainte communion peuvent réciter trois fois Domine non sum dignus, avec le prêtre célébrant.
d) Le Sanctus et le Benedictus, s'ils sont chantés sur les mélodies grégoriennes, doivent être chantés à la suite, sinon on reportera le Benedictus après la consécration.
e) Pendant que s'accomplit la consécration, tout chant doit cesser et, là où la coutume est en vigueur, même le jeu de l'orgue et de tout instrument de musique.
f) La consécration achevée, à moins qu'on ne doive encore chanter le Benedictus, on conseille un silence sacré jusqu'au Pater noster.
g) Pendant que le prêtre célébrant bénit les fidèles à la fin de la messe, l'orgue doit se taire ; et le prêtre célébrant doit prononcer les paroles de la bénédiction de telle sorte qu'elles puissent être entendues par tous les fidèles.
c) De la participation des fidèles aux messes lues.
28. On doit déployer tous ses soins pour que les fidèles qui assistent aux messes lues ne soient pas « comme des étrangers et des spectateurs muets » [13], mais qu'ils fournissent cette participation qui est requise par un si grand mystère, et qui procure des fruits très abondants.
29. La première manière dont les fidèles peuvent participer à la messe lue est obtenue lorsque individuellement, par leur propre effort, ils fournissent une participation intérieure, c'est-à-dire une pieuse attention aux parties principales de la messe, ou encore une participation extérieure, selon les coutumes approuvées qui varient selon les régions.
En ce domaine sont particulièrement dignes de louanges ceux qui, ayant en main un missel adapté à leurs capacités, prient en union avec le prêtre, en employant les mêmes paroles que l'Église. Mais comme tous ne sont pas également capables de bien comprendre les rites et les formules liturgiques, et comme en outre les besoins spirituels ne sont pas les mêmes chez tous et ne demeurent pas toujours les mêmes en chacun, pour ceux-ci une autre méthode de participation plus adaptée ou plus facile est possible, qui consiste « à méditer pieusement les mystères de Jésus-Christ, ou à accomplir d'autres exercices de piété et à formuler d'autres prières qui, bien qu'elles diffèrent par leur forme des rites sacrés, cependant s'y accordent par leur nature » [14].
Il faut noter en outre que si, quelque part, à la messe lue, on a l'habitude de jouer de l'orgue, sans que les fidèles participent à la messe soit par les prières communes, soit par le chant, on doit réprouver l'usage de jouer sans interruption de l'orgue, de l'harmonium ou d'un autre instrument de musique. Ces instruments doivent donc faire silence :
a) Après l'arrivée du prêtre célébrant à l'autel, jusqu'à l'offertoire ;
b) Des premiers versets avant la Préface jusqu'au Sanctus inclusivement ;
c) Là où c'est la coutume, de la consécration au Pater noster ;
d) De l'Oraison dominicale à l'Agnus Dei inclusivement ; au Confiteor qui précède la communion des fidèles ; pendant qu'on dit la Postcommunion et qu'on donne la bénédiction à la fin de la messe.
30. On obtient le deuxième mode de participation lorsque les fidèles participent au sacrifice eucharistique en exécutant des prières et des chants communs. Il faut veiller à ce que prières et chants soient parfaitement accordés aux différentes parties de la messe, mais en maintenant la prescription du n° 14 c.
31. Enfin on obtient le troisième mode de participation, et celui-ci est le plus complet, lorsque les fidèles répondent liturgiquement au prêtre célébrant, en « dialoguant » avec lui, comme on dit, et en disant à voix haute les parties qui leur sont propres.
Dans cette participation plus complète on peut distinguer quatre degrés.
a) Le premier degré, si les fidèles donnent les réponses liturgiques les plus faciles au prêtre célébrant, savoir : Amen ; Et cum spiritu tuo ; Deo gratias ; Gloria, tibi, Domine ; Laus tibi, Christe ; Habemus ad Dominum ; Dignum et justum est ; Sed libera nos a malo.
b) Le deuxième degré, si les fidèles exécutent en outre les parties qui, selon les rubriques, doivent être dites par le servant ; et si la sainte communion est distribuée à la messe, s'ils disent aussi le Confiteor et le triple Domine, non sum dignus.
c) Le troisième degré, si les fidèles récitent aussi avec le prêtre célébrant les parties suivantes de l'Ordinaire de la messe : Gloria in excelsis Deo ; Credo ; Sanctus-Benedictus ; Agnus Dei.
d) Enfin le quatrième degré, si les fidèles prononcent aussi avec le prêtre célébrant les parties appartenant au Propre de la messe : Introït ; Graduel ; Offertoire ; Communion. Ce dernier degré ne peut être réalisé dignement, comme il convient, que par des groupements choisis, bien exercés et bien formés.
32. Dans les messes lues, tout le Pater noster, puisqu'il est la prière qui de toute antiquité prépare à la communion, peut être récité par les fidèles avec le prêtre célébrant, en latin seulement, et tous ajoutant Amen, à l'exclusion de toute récitation en langue vulgaire.
33. Dans les messes lues, des chants populaires religieux peuvent être chantés par les fidèles, en observant toutefois cette loi, qu'ils soient tout à fait accordés à chacune des parties de la messe (cf. n° 14 b).
34. Le prêtre célébrant, surtout s'il est dans un grand vaisseau et que le peuple soit nombreux, dira tout ce que selon les rubriques il doit prononcer clara voce d'une voix assez haute pour que tous les fidèles puissent suivre l'action sacrée au fur et à mesure, et commodément.
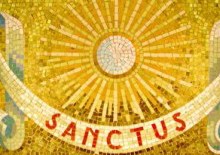
d) De la messe « conventuelle », qu'on appelle aussi : messe « in choro ».
35. Parmi les actions liturgiques qui l'emportent par une dignité particulière, on compte à bon droit la messe « conventuelle » ou « in choro », c'est-à-dire celle qui doit être célébrée quotidiennement en liaison avec l'office divin, par ceux que les lois de l'Église astreignent au choeur.
En effet, la messe unie à l'office divin constitue le sommet de tout le culte chrétien, soit cette louange plénière qui est rendue au Dieu tout-puissant chaque jour, par une solennité extérieure et publique.
Mais comme cette offrande plénière du culte, publique et collégiale, ne peut être accomplie chaque jour dans toutes les églises, elle est donc accomplie par ceux qui y sont députés par la loi « du choeur » comme à titre de représentants, ce qui vaut surtout pour les églises cathédrales à l'égard du diocèse tout entier.
Aussi toutes les célébrations « chorales » doivent être ordinairement accomplies avec un éclat et une solennité particulières, c'est-à-dire recevoir l'embellissement du chant et de la musique sacrée.
36. Donc, de soi, la messe conventuelle doit être une messe solennelle ou du moins une messe chantée.
Mais là où, en vertu de lois particulières ou d'indults spéciaux, on a été dispensé de solenniser la messe « chorale », qu'on évite au moins totalement que les heures canoniques ne soient récitées pendant la messe conventuelle. Il convient au contraire, que la messe conventuelle lue soit accomplie dans la forme qui est proposée au n° 31, en excluant cependant tout usage de la langue maternelle.
37. En ce qui concerne la messe conventuelle, on observera en outre ce qui suit :
a) Chaque jour on ne dira qu'une seule messe conventuelle, qui doit concorder avec l'Office récité au choeur, à moins que les rubriques n'en aient disposé autrement (Additiones et Variationes in rubricis Missalis, tit. I, n. 4). Cependant l'obligation de célébrer d'autres messes au choeur, en vertu de fondations pieuses ou pour un autre motif légitime, demeure en vigueur.
b) La messe conventuelle suit les normes de la messe chantée, ou de la messe lue.
c) La messe conventuelle doit être dite après tierce, à moins que le supérieur de la communauté, pour une cause grave, ne décide qu'elle doit être dite après sexte ou après none.
d) Les messes conventuelles « extra chorum », jusqu'à présent prescrites à certains jours par les rubriques, sont supprimées.
e) De l'assistance des prêtres au saint Sacrifice de la messe, et des messes qu'on appelle « synchronisées ».
38. Étant donné tout d'abord que la concélébration sacramentelle dans l'Église latine se limite aux cas fixés par le droit ; ayant rappelé ensuite la réponse de la Suprême Congrégation du St-Office en date du 23 mai 1957 [15], où est déclarée invalide la concélébration du sacrifice de la messe par des prêtres qui, bien que revêtus des ornements sacrés et conduits par quelque intention que ce soit, ne prononcent pas les paroles de la consécration : il n'est pas interdit que, lorsque de nombreux prêtres sont réunis, à l'occasion de Congrès, « un seul célèbre la messe tandis que les autres (tous ou le plus grand nombre) assistent à cette unique messe et y reçoivent la sainte communion de la main du célébrant », pourvu « que cela se fasse pour un motif juste et raisonnable et que l'Évêque n'en ait pas décidé autrement pour éviter l'étonnement des fidèles », et que cette façon d'agir ne recouvre pas l'erreur signalée par le souverain Pontife Pie XII, à savoir que la célébration d'une seule messe à laquelle cent prêtres assistent pieusement équivaudrait à la célébration de cent messes par cent prêtres [16].
39. Mais sont prohibées les messes dites « synchronisées », c'est-à-dire cette façon particulière de célébrer la messe, selon laquelle deux prêtres ou davantage, à un seul ou à plusieurs autels, célèbrent la messe simultanément de telle sorte que toutes les actions sont accomplies et toutes les paroles proférées en même temps, en employant même, surtout si le nombre des prêtres célébrant ainsi est considérable, certains instruments modernes qui permettent d'obtenir cette uniformité ou « synchronisation » de manière absolue.
B. De l'office divin
40. L'Office divin est acquitté soit « in choro », soit « en commun » ou « par un seul ».
Il est dit célébré « in choro » si l'Office divin est acquitté par une communauté que les lois ecclésiastiques obligent au choeur ; mais « en commun » si c'est le fait d'une communauté qui n'est pas astreinte au choeur.
L'Office divin, de quelque façon qu'il soit acquitté, soit « in choro », soit « en commun », soit « par un seul », s'il est accompli par ceux qui sont députés à l'accomplissement de l'Office par les lois ecclésiastiques, doit toujours être tenu comme un acte du culte public, rendu à Dieu au nom de l'Église.
41. Par sa nature, l'Office divin est constitué de telle sorte qu'il soit exécuté par voix mutuelles et alternées ; bien plus, certaines parties exigent, de soi, d'être chantées.
42. Ceci étant établi, on doit maintenir et favoriser l'accomplissement de l'Office divin « in choro » ; quant à l'accomplissement « en commun », comme aussi le chant d'au moins une partie de l'Office, selon l'opportunité des lieux, des temps et des personnes, il est vivement recommandé.
43. La récitation des psaumes « in choro » ou « en commun », qu'elle se fasse avec la mélodie grégorienne, ou bien sans chant, doit être grave et digne, en observant la hauteur de ton qui convient, la pause convenable, et un plein accord des voix.
44. Si les psaumes qui figurent dans une heure canoniale doivent être chantés, ils doivent être chantés au moins en partie avec les mélodies grégoriennes, soit pour un psaume sur deux, soit pour un verset sur deux dans le même psaume.
45. La coutume ancienne et vénérable de chanter vêpres selon les rubriques, en union avec le peuple, aux dimanches et aux jours de fêtes, cette coutume doit être gardée là où elle est en vigueur ; là où elle n'existe pas, on l'introduira, autant que faire se peut, quelquefois au moins dans l'année.
De plus, les Ordinaires des lieux feront effort pour qu'à l'occasion de la messe du soir, le chant des vêpres les dimanches et jours de fêtes ne tombe pas en désuétude. En effet, les messes du soir que l'Ordinaire du lieu peut permettre « si le bien spirituel d'une partie notable des chrétiens le demande » [17], ne doivent pas nuire aux actions liturgiques et aux pieux exercices par lesquels le peuple fidèle a coutume de sanctifier les jours de fête.
C'est pourquoi l'usage de chanter les vêpres, ou de célébrer d'autres pieux exercices avec la Bénédiction eucharistique, doit être conservé là où il est en vigueur, même si on célèbre la messe du soir.
46. Dans les séminaires de clercs, soit séculiers soit religieux, on doit accomplir assez souvent en commun au moins une partie de l'Office divin et, autant que possible, avec chant ; les dimanches et jours de fêtes on doit chanter au moins les vêpres (cf. can. 1367, 3°).
C. De la bénédiction apostolique
47. La Bénédiction eucharistique est une véritable action liturgique ; par conséquent, elle doit se faire telle qu'elle est décrite dans le Rituel Romain, tit. 10, ch. 5, no 5.
Mais là où, en vertu d'une tradition immémoriale, on pratique une autre manière de donner la Bénédiction eucharistique, cette manière peut être conservée, avec la permission de l'Ordinaire ; on conseille cependant de promouvoir la coutume romaine pour la Bénédiction eucharistique.
____________________
[1] Encyclique Mediator Dei du 20 novembre 1947 : A.A.S. 39 (1947) 528-529.
[2] Cf. Eph. 5, 18-20 ; Col. 3, 16.
[3] Encyclique Musicae sacrae disciplina, du 25 décembre 1955 : A.A.S. 48 (1956) 13-14.
[4] Encyclique Musicae sacrae disciplina : A.A.S. 48 (1956) 13.
[5] Motu proprio Tra le sollecitudini, du 22 novembre 1903, n° 7 : A.S.S. 36 (1903-1904) 334 ; Decr. auth. S.R.C. 4121.
[6] Encyclique Musicae sacrae disciplina : A.A.S. 48 (1956) 16-17.
[7] Encyclique Mediator Dei, du 20 novembre 1947 : A.A.S. 39 (1947) 552.
[8] A.A.S. 39 (1947) 560.
[9] Encyclique Mediator Dei : A.A.S. 39 (1947) 530-537.
[10] Concile de Trente, Sess. 22, ch. 6 [Denz. 944]. Cf. aussi l'encyclique Mediator Dei (A.A.S. 39 [1947] 565) : « II est tout à fait convenable, ce que d'ailleurs la liturgie a établi, que le peuple s'approche de la sainte Table après la communion du prêtre. »
[11] Concile de Trente, Sess. 22, ch. 8 [Denz. 946] ; Encyclique Musicae sacrae disciplina : A.A.S. 48 (1956) 17.
[12] Encyclique Musicae sacrae disciplina : A.A.S. 48 (1956) 16.
[13] Constitution Apostolique Divini cultus, du 20 décembre 1928 : A.A.S. 21 (1929) 40.
[14] Encyclique Mediator Dei : A.A.S. 39 (1947) 560-561.
[15] A.A.S. 49 (1957) 370.
[16] Cf. Allocutions du Souverain Pontife Pie XII aux Cardinaux et Évêques, du 2 novembre 1954 (A.A.S. 46 [1954] 669-670) et aux participants du Congrès International de Pastorale Liturgique tenu à Assise, le 22 septembre 1956 (A.A.S. 48 [1956] 716-717).
[17] Constitution Apostolique Christus Dominus, du 6 janvier 1953 (A.A.S. 45 [1953] 15-24). Instruction de la Suprême Congrégation du S. Office du même jour (A.A.S. 45 [1953] 47-51). Motu proprio Sacram Communionem du 19 mars 1957 (A.A.S. 49 [1957] 177-178).
 Sacrosanctum Concilium
Sacrosanctum Concilium